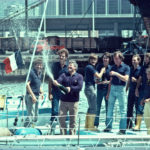Ces pionniers de la course autour du monde en équipage
Voici le premier d’une série de reportages célébrant le fort héritage français de The Ocean Race. Réalisés en coopération avec l’IMOCA, ces récits mettent en lumière 50 ans de « French Connection », depuis le début de la Whitbread Round the World Race en 1973.
Dans un an, ils caracoleront dans l’océan Indien à l’occasion de The Ocean Race (*) disputée pour la première fois en IMOCA, ainsi que sur les monotypes VO65. Jamais une étape – entre Cape Town en Afrique du Sud et Itajaí au Brésil – n’aura été aussi longue avec 12 750 milles, soit 23 613 kms. Il y a cinquante ans, des marins de tous horizons effectuaient le premier tour du monde en équipage d’une course baptisée Whitbread Round the World Race. L’IMOCA et The Ocean Race ont replongé dans cette folle épopée qui se prolonge un demi-siècle plus tard.
Quand ce 8 septembre 1973, dix-neuf voiliers de sept nations dont un tiers sont Français, quittent Portsmouth et les eaux vertes du Solent avant de mettre le cap sur l’Afrique du Sud, il y a non seulement le stress inhérent à tout départ de course, mais aussi une sacrée dose d’inconnu face à ces 27 000 milles, notamment les fameux quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants dans l’océan Indien puis Pacifique. Quelques années auparavant la légende prétend que l’ancien aviateur Sir Francis Chichester, vainqueur à soixante ans de la première Transat Anglaise (Ostar), quatre ans avant Eric Tabarly, aurait eu l’idée de cette course autour du monde en équipage avec quelques sommités britanniques dont Robin Knox-Johnston, vainqueur du Golden Globe en 1969, ainsi que l’amiral Otto Steiner. La course est baptisée Whitbread Round The World Race car sponsorisée par le célèbre brasseur britannique. Ce premier tour du monde se dispute en quatre longues étapes entre Portsmouth, Le Cap, Sydney, Rio et Portsmouth. Un bateau noir ne passe pas inaperçu sur les pontons. Pen Duick VI, un ketch de 22 mètres, a été spécialement dessiné par André Mauric pour cette course, équipé d’un lest en uranium appauvri et de pièces en titane. Il est skippé par Éric Tabarly accompagné de jeunes et talentueux équipiers dont on va bientôt entendre parler – Olivier de Kersauson, Philippe Poupon, Marc Pajot… La plupart des voiliers sont de véritables « coffres forts » lents et lourds, et chargés à bloc de boîtes de conserves, et jerrycans d’eau.
Des voiliers de course-croisière aussi robustes que confortables
En 1973, il n’y a encore ni nourriture lyophilisée ni dessalinisateur sur les voiliers, mais des couchettes moelleuses, un chauffage d’appoint afin d’essayer de faire sécher les cirés en vinyle issus de la pêche, et même des pantoufles. Il est de bon ton d’embarquer un médecin à bord vu que les communications via la BLU sont totalement aléatoires – le futur explorateur Jean-Louis Etienne par exemple sur Pen Duick – et surtout un cuistot, hors quart, devant les « fourneaux » de la cuisine presque comme à la maison.
La presse britannique promet un duel au sommet entre Éric Tabarly et Chay Blyth sur Great Britain II. Cet ancien militaire a établi le record du tour du monde en solitaire contre les vents dominants deux ans plus tôt et en 292 jours quand les Anglais ont découvert Tabarly lors de sa victoire dans l’Ostar en 1964. Les deux marins partent clairement pour gagner. Le commando de parachutistes – de solides gaillards mais guère marins –, recruté par Blyth se plaint de manger que des plats bourratifs à base de curry. L’on frôle la mutinerie. Blyth, va finir par reconnaître à l’arrivée en Afrique du Sud « que même les parachutistes sont des êtres humains… ». On imagine l’ambiance à bord.
Sayula II, équipage vainqueur de la Whitbread Round the World Race 1973-74 I © Bernardo Arsuaga Private Collection
Rien de tel sur Sayula II, un Swan 65, dessiné par le prestigieux cabinet américain Sparkman et Stephens, construit en Finlande et considéré à l’époque comme la « Rolls » des bateaux de course-croisière. Le milliardaire mexicain Ramon Carlin, a tout compris. Il a enrôlé certes son fils, modeste plaisancier, mais aussi de brillants marins. Pendant que les jeunes torchent de la voile sur le pont, le skipper et ses convives profitent. « Nous avons de l’alcool à bord et il nous arrive de prendre un verre ensemble après dîner ou en fin de quart, lorsque nous rentrons trempés et glacés » explique ce bon vivant. « Certains ne prêtent aucune attention au fait que nous avons quelques femmes à bord (notamment Paquita son épouse). Leur présence est une excellente chose. » N’empêche, la légende ne dit pas vraiment combien elles sont à bord, mais prétend que ces dames vont débarquer au Cap, préférant retrouver leur conjoint aux escales.
Un blondinet de 25 ans nommé Peter Blake
A bord de Pen Duick VI, et même s’il y a une guitare, des carnets de chants et du Châteauneuf du Pape – le vin préféré de Tabarly – les emménagements sont nettement moins douillets, et l’équipage pousse le ketch dans ses derniers retranchements. Des images tournées à bord, montrent des équipiers hors-quart en slip, grimpant à toute vitesse sur le pont sans harnais, afin d’aider à affaler l’immense spi lors d’un départ au lof dans un grain puissant, le bateau roulant bord sur bord. Un miracle qu’il n’y ait pas eu de blessés. Le favori va perdre toute chance de l’emporter quand son mât s’écroule sur le pont. Un nouveau mât sera installé en Afrique du Sud. Un autre équipage passe plus de temps à utiliser la caisse à outils qu’à régater. Sur ce bateau battant pavillon britannique, un blondinet néozélandais de 25 ans, dispute la première de ses cinq Whitbread consécutives. Il se nomme Peter Blake, et a été enrôlé comme équipier sans spécialité. Dans son journal de bord, il raconte : « Nous n’avons encore jamais navigué sur ce bateau, et le départ est notre première sortie en mer ! On termine les emménagements intérieurs dans le Solent. Heureusement, il fait beau… Nous n’avons pas vérifié que les toilettes n’étaient pas connectées, et au bout d’une semaine, on se rend compte que tout part dans les fonds où sont stockées les conserves. Et comme dans la panique du départ, nous avons rangé les boîtes sans les référencer, les étiquettes se sont décollées et quand on en ouvre une, c’est la surprise ! »
Philippe Facque : « J’avais 21 ans et l’opportunité de faire le tour du monde en course ! »
Après des mois de mer, Sayula II l’emporte en temps compensé devant un confortable Nicholson 55 baptisé Adventure et Grand Louis du Français André Viant. L’on compte malheureusement trois disparus, dont le Français Dominique Guillet, co-skipper de 33 Export, et cinq bateaux non classés. La course a été sans pitié, et le skipper du bateau polonais Otago, bon marin mais amateur patenté, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : « Il est vraiment difficile de vivre dans un espace aussi restreint et dans cette promiscuité. Même des rats ne pourraient vivre ainsi les uns sur les autres sans se quereller de temps en temps ! » A écouter Philippe Facque, aujourd’hui directeur général du chantier CDK, mais qui en 1973, a posé son sac sur le bateau d’André Viant, les souvenirs n’ont pas tout à fait le même goût. Deux ans auparavant, et au grand dam de ses parents, il a zappé les oraux du Bac ayant l’opportunité d’effectuer sa première transat.
Repéré par André Viant pour ses qualités de manœuvrier, il lui propose d’embarquer à bord de Grand Louis pour la première Whitbread. « J’avais 21 ans et l’opportunité de faire le tour du monde en course. C’était juste génial ! Contrairement à Kriter mené par Jack Grout où il n’y avait que des stars à bord mais qui ne s’entendaient pas, chez nous, il y avait une super ambiance, cette complicité et confiance, indispensables sur une telle course. Nous étions dix, fonctionnions par quarts de trois – un sur le pont, un en stand-by et un à la bannette. Il y avait un mix de la famille d’André Viant, polytechnicien, chef d’entreprise, formidable marin – ses filles Françou et Sylvie, son fils Jimmy, son gendre Michel Vanek… et de jeunes marins dont Loïc Caradec et moi. Grand-Louis était une goélette confortable mais un tank qui n’avançait pas. Je me souviens que dans l’océan Indien, pour tuer le temps, on se faisait des crêpes… Comme c’était la première course autour du monde, tout le monde partait avec des bateaux lourds et robustes. On ne savait pas trop à quoi s’attendre. » Il a beau diriger le chantier CDK qui a construit nombre de voiliers IMOCA, dont six vainqueurs du Vendée Globe ou le dernier 11th Hour Racing Team, Philippe Facque, n’a jamais navigué sur ces bateaux. « Ce qui est hallucinant avec ces foilers, c’est qu’ils ont des performances supérieures aux trimarans Orma de 60 pieds d’il y a trente ans. Ces bateaux sont fabuleux, mais à cinq dans les mers du Sud, ça sera forcément sportif et physiquement exigeant. Ces coques en carbone sont d’incroyables caisses de résonnance. Mais en même temps depuis cinquante ans, la course s’est tellement professionnalisée, et les marins d’aujourd’hui sont hyper préparés et encore plus « durs au mal » que nous. Je me pose parfois la question. Si j’avais leur âge aujourd’hui (il en a 70), est-ce que je prendrais mon pied à faire un tour du monde en équipage sur ces machines extraordinaires ? Je crois quand même que oui… Ils vont aller trois fois plus vite, moins cuisiner que nous à bord c’est sûr, mais vivre une aventure exceptionnelle, unique et rare » conclue-t-il en riant.